Edward Steichen : un photographe d’art, de mode et de guerre

Découvrez l’incroyable parcours d’Edward Steichen, une figure incontournable de l’histoire de la photographie. De ses débuts en tant que photographe de mode à ses exploits en tant que directeur du département de photographie du MoMA, Steichen a marqué de son empreinte l’évolution de l’art photographique au 20ème siècle. À travers ses expositions emblématiques comme The Family of Man et The Bitter Years, il a su capter l’humanité dans toute sa diversité et sa complexité, tout en contribuant à façonner la photographie humaniste. Dans cet épisode de Nicéphore, plongez dans l’œuvre d’un artiste dont l’influence résonne encore aujourd’hui. Une rétrospective inédite, entre émotion, histoire et photographie, vous attend. Edward Steichen, iconographe d’art À 21 ans, en 1898, Steichen expose ses premières œuvres au salon de Philadelphie, aux côtés de grands photographes comme Alfred Stieglitz, marquant ainsi le début de sa carrière exceptionnelle dans le monde de la photographie d’art. En 1900, il rencontre Alfred Stieglitz à New York, et intègre l’Académie Julian à Paris, où il se plonge davantage dans l’art de la photographie. Rapidement, il abandonne ses études pour créer sa série iconique Grands Hommes, qui inclut des portraits d’artistes célèbres tels qu’Auguste Rodin, consolidant ainsi sa réputation en tant que photographe portraitiste de renom. Après deux ans passés à Paris, où il expose et devient membre du Linked Ring en 1901, il retourne aux États-Unis. Aux côtés de Alfred Stieglitz, il cofonde le mouvement Photo-Secession et contribue activement à Camera Work. En parallèle de sa carrière photographique, Steichen travaille à la galerie 291 à New York, où il expose des artistes de renom. Marié à Clara Smith, il partage son temps entre l’Europe et les États-Unis. En 1910, il participe à l’exposition internationale de Buffalo, avant de se détacher du Photo-Secession pour se concentrer sur sa carrière individuelle. Steichen, iconographe de mode et de guerre En 1911, Edward Steichen reçoit une commande révolutionnaire de Lucien Vogel, propriétaire de Art et Décoration. Il réalise onze photographies des robes de Paul Poiret pour accompagner l’article « L’art de la robe » de Paul Cornu, illustré par Georges Lepape. Avec cette série, Steichen établit la photographie de mode moderne, alliant beauté artistique et potentiel commercial. Cependant, cette avancée est interrompue par la Première Guerre mondiale, un tournant décisif dans la carrière de Steichen. En 1915, Edward Steichen initie la Straight Photography, un mouvement prônant des images réalistes et sans manipulation. Ce changement, influencé par les horreurs de la guerre, reflète la quête de vérité dans l’art. En 1917, il devient lieutenant dans la section photographique de l’armée américaine, supervisant la photographie de reconnaissance aérienne en France. Après la Première Guerre mondiale, Edward Steichen traverse une crise personnelle, abandonne la peinture et se concentre sur la photographie réaliste. En 1923, il devient photographe en chef de Vogue et Vanity Fair. Il crée une esthétique chic, caractérisée par des éclairages francs et des compositions graphiques, immortalisant des icônes du cinéma comme Greta Garbo et Marlene Dietrich, ou encore la danseuse contemporaine Marthe Graham. Deux œuvres emblématiques marquent cette période : la première couverture couleur de Vogue en 1932 et le portrait célèbre de Gloria Swanson derrière une dentelle noire. À 60 ans, Edward Steichen rejoint la Seconde Guerre mondiale en 1942 comme responsable de l’unité photographique navale. En 1944, il réalise The Fighting Lady¹, un documentaire primé par un Oscar. À la fin de la guerre, il devient directeur de l’unité photographique des combats navals, puis de l’Institut photographique naval. Steichen, directeur du département de photographie au MoMA En 1947, Edward Steichen devient conservateur du MoMA et crée The Family of Man², une exposition humaniste qui réunit 503 photographies de 273 photographes, attirant plus de 10 millions de visiteurs. En 1962, il supervise The Bitter Years, une série de photographies sur la Grande Dépression, comprenant plus de 200 photographies de la Farm Security Administration. Steichen meurt le 25 mars 1973, à deux jours de son 94ème anniversaire. En 2006, son cliché The Pond-Moonlight (1904) se vend pour 2,9 millions de dollars, devenant l’une des photographies les plus chères du monde. ¹ The Fighting Lady (1944) I Airboyd² Human Version Cinéma I Human Le Film
Alfred Stieglitz : le pionnier new-yorkais de la photographie pictorialiste

Alfred Stieglitz, visionnaire et pionnier de la photographie, transforme ce médium en un art à part entière. Né en 1864 dans le New Jersey et issu d’une famille aisée, Stieglitz découvre la photographie en Allemagne. Inspiré par le pictorialisme et guidé par Hermann Wilhelm Vogel, il se fait remarquer grâce à sa photographie The Last Joke, Bellagio. À son retour à New York en 1890, il bouscule les conventions : après un passage en photogravure, il fonde la Photographic Secession et ouvre la célèbre Little Gallery, où il expose les œuvres révolutionnaires de photographes comme Steichen et Käsebier. Sa photo The Terminal marque un tournant, initiant son style moderniste. Mais qu’est-ce qui a vraiment motivé son parcours audacieux ?
Julia Margaret Cameron : la 1ère femme photographe avant-gardiste

Dans Annales de ma maison de verre, Virginia Woolf dresse un portrait admiratif et mystérieux de sa grand-tante, Julia Margaret Cameron, pionnière de la photographie ayant défié les conventions victoriennes. Née en 1815 à Calcutta, Cameron, imprégnée de cultures orientales et occidentales, découvre la photographie à 48 ans et fait de ses proches et célébrités les modèles d’un langage visuel inédit. Malgré les critiques, elle transforme le flou en art, capturant l’essence de son temps. Inspirée par Woolf, explorez ici l’héritage fascinant de cette artiste avant-gardiste qui, par son regard, réinventa la photographie.
Pictorialisme : l’amateurisme comme revendication

Le Pictorialisme (de l’anglais pictoral, « pictural ») est un mouvement photographique daté de 1890 à 1914. Les pictorialistes sont les héritiers des photographes victoriens et, revendiquent l’amateurisme. Ils perçoivent la photographie comme un médium pouvant transmettre l’expression des sentiments grâces à l’intervention manuelle humaine. C’est pourquoi les sujets traités sont similaires aux genres picturaux : études artistiques, nus, scènes de genres, scènes religieuses, paysages et scènes historiques.
La Photographie Victorienne : une entrée dans l’art
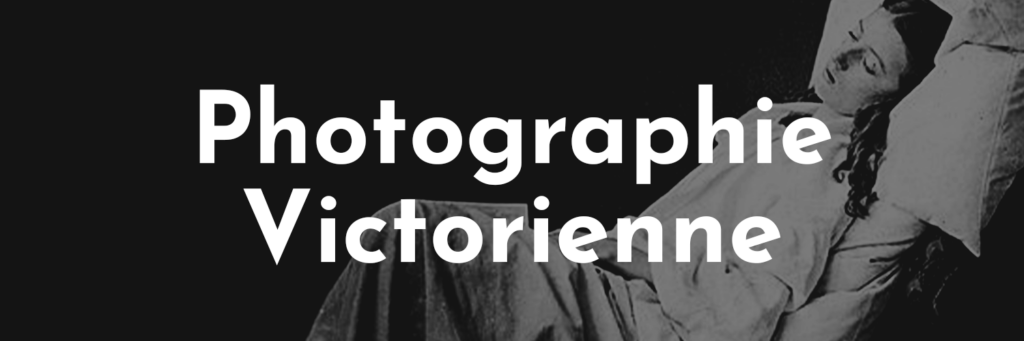
En 1839, le daguerréotype, nouvelle invention française, fascine le monde en promettant de figer la réalité avec une précision inédite. Mais en 1850, lorsque quelques photographes émergents revendiquent son potentiel artistique, l’idée suscite des remous. Les peintres, déjà en concurrence avec les photographes pour la reproduction architecturale et naturelle, voient d’un mauvais œil l’élévation de la photographie au rang de beaux-arts, redoutant une menace pour leur métier.