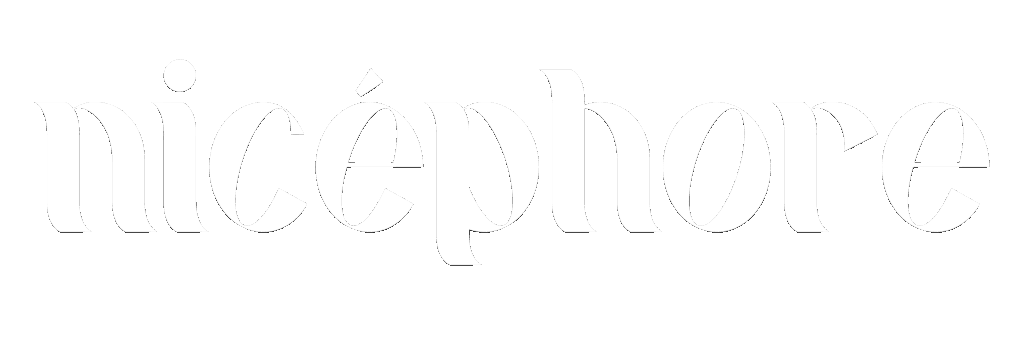Spirit Photography
À travers cet épisode, plongeons dans l’histoire de la Spirit Photography et des techniques qui ont servi la quête inépuisable de l’homme pour rendre visible l’invisible.

En 1865, la Guerre de Sécession s’achève, laissant derrière elle un bilan humain dévastateur avec entre 620 000 et 750 000 soldats morts. Les familles américaines, marquées par des années de brutalité, pleurent leurs disparus et se tournent vers le spiritisme pour tenter de reprendre contact avec les âmes des défunts.
C’est alors que William Mumler, pionnier de la photographie spirite, gagne en notoriété. Grâce à ses photographies de fantômes, il offre aux endeuillés une chance d’apercevoir leurs proches disparus. Parmi ses clients, on compte même Mary Todd Lincoln, qui sollicite un portrait aux côtés de son mari défunt, Abraham Lincoln.
En 1873, Édouard Buguet, célèbre photographe-médium, ouvre son studio à Paris, offrant aux visiteurs l’opportunité de capturer des portraits de fantômes. Puis, en 1891, une photographie de Sybell Corbet prise dans la bibliothèque de Combermere Abbey secoue l’Angleterre et devient l’une des images les plus célèbres de la photographie spirite.
À l’aube du XXe siècle, un autre Britannique, William Hope, se distingue. Ce photographe spirite immortalise les vivants et les morts dans son studio et devient président du Crewe Circle, groupe influent de photographes spirites britanniques.
En Europe et aux États-Unis, des femmes médiums collaborent avec des photographes pour promouvoir leurs séances de spiritisme³. Georgiana Houghton, en partenariat avec Frederick Hudson, est l’une des premières à lancer la photographie spirite avec des reproductions de fantômes.
Des photographes comme Fred Barlow et Frederick Hudson documentent également les séances de médiums moins connues, notamment à travers la photographie ectoplasmique, une technique fascinante et controversée. Ces images, qui capturent des ectoplasmes, offrent un regard ambivalent et souvent érotique sur les médiums, alliant horreur et fascination.

Qu’elle soit psychique ou ectoplasmique, la photographie spirite connaît un succès éphémère avant d’être entachée de scandales. En avril 1869, William Mumler est accusé de fraude après que certains de ses « esprits » aient été reconnus vivants dans les rues américaines. En 1875, le photographe parisien Édouard Buguet est arrêté pour escroquerie et avoue ses manipulations. Puis en 1888, Margaret Fox révèle que les manifestations paranormales de sa jeunesse étaient en réalité un canular.
La photographie ectoplasmique, quant à elle, dévoile les truquages de médiums, qui dissimulaient leurs mains pour manipuler des tissus en gaze, créant des apparitions spectrales.
Quelques références :
BAUDOIN, P., EDELMAN, N. (2021), Surnaturelles : une histoire visuelle des femmes médiums, éd. Pyramyd.
Découvre aussi…